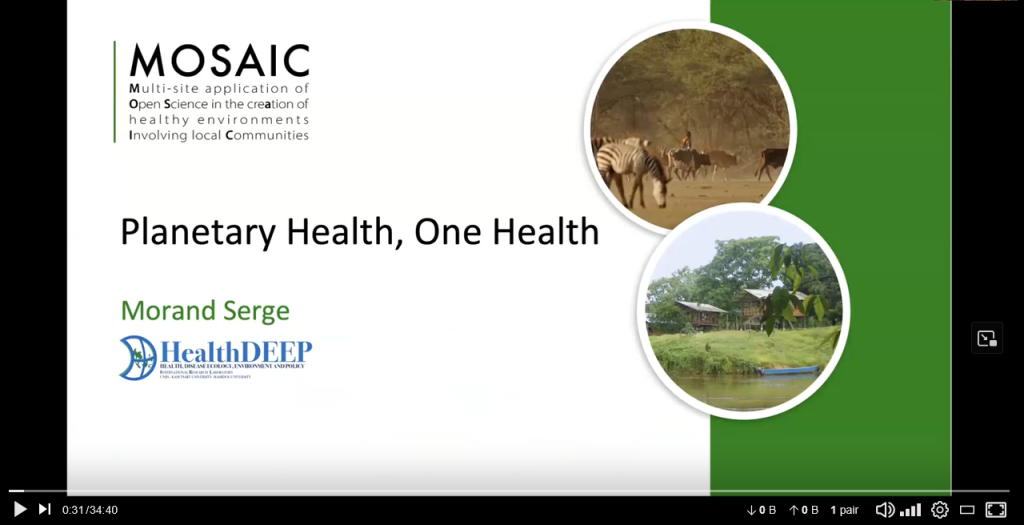Contexte
Les changements et dégradations environnementales, ainsi que les événements climatiques extrêmes, qu’ils résultent de changements globaux ou d’actions anthropiques locales, ont des impacts directs et indirects sur les moyens de subsistance, la santé et le bien-être des populations humaines.
Ces impacts et la capacité à les anticiper, à y faire face et à s’en remettre, dépendent des spécificités territoriales locales. En particulier, des problèmes spécifiques découlent des zones transfrontalières situées aux frontières internationales, qui exposent davantage les populations locales aux événements défavorables et les rendent plus vulnérables. Cela s’explique notamment par : la forte mobilité des personnes, des animaux et des agents pathogènes ; le fonctionnement non nominal des systèmes de santé ; l’absence de coopération transfrontalière et de partage de données, d’informations et de connaissances comparables, qui empêche les pays voisins d’avoir une représentation commune et partagée de la situation, et donc de concevoir des solutions concertées et de mener des actions conjointes.
Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre en place des solutions d’adaptation et d’atténuation acceptables, réalisables et durables, impulsées par les populations locales, qui peuvent/devraient inspirer les États et les institutions internationales à plus grande échelle. Cela représente un défi particulier en raison : d’une compréhension partielle et/ou erronée des impacts négatifs et positifs réciproques entre l’environnement, les changements environnementaux et la santé, le bien-être et les pratiques humaines ; du fait que les communautés locales bénéficient rarement des bases de données et des systèmes de surveillance existants ; du manque d’expertise locale et d’outils ouverts, interactifs et interconnectés pour soutenir la prise de décision en matière de santé, de conservation de la biodiversité, de moyens de subsistance et de bien-être ; de la nature multiculturelle et multilingue des zones transfrontalières.

David Western, African Conservation Centre
Les éleveurs Maasaï sont traditionnellement nomades, se déplaçant en fonction de la disponibilité en eau et en pâturages pour leur bétail. Les sécheresses intenses de ces dernières années ont contraint les éleveurs à se déplacer plus souvent, pendant des périodes plus longues et sur des distances plus importantes, ce qui a des répercussions sur leur santé et leur bien-être.
En Afrique de l’Est,
Les éleveurs Maasaï vivant dans le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie sont confrontés à des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes. Ce phénomène est exacerbé par le surpâturage qui réduit considérablement la disponibilité en eau et en pâturages nécessaires à la survie du bétail et de la faune sauvage. Il en résulte une mortalité animale élevée, des déplacements de troupeaux et de populations, des conflits entre les humains et la faune sauvage, ainsi que des problèmes de santé parmi la population humaine (malnutrition, problèmes de santé mentale, difficultés d’accès à la prévention et aux soins, conditions de vie précaires, risque accru de tuberculose pour les éleveurs qui passent du temps loin de chez eux, VIH/SIDA pour les conjoints séparés, dépression, etc.).
En Amazonie,
Les changements dans la couverture et l’utilisation des sols dus aux activités anthropiques, en particulier la déforestation pour l’exploitation forestière, l’expansion urbaine, la création de pâturages ou de cultures intensives, l’exploitation aurifère, la construction de barrages, etc. ont des effets bien documentés sur la santé et le bien-être des populations. En effet, en modifiant les habitats, les réservoirs (notamment les mammifères tels que les chauves-souris et les singes) et les vecteurs (notamment les moustiques, les phlébotomes et les triatomes) des agents pathogènes (tels que Leishmania, Plasmodium, les virus, les bactéries et les champignons) peuvent proliférer, exposant davantage la population humaine à plusieurs maladies infectieuses.

Antoine Boyrie et Anne-Elisabeth Laque, IRD, 2012
La déforestation est l’un des changements les plus courants dans l’utilisation des terres en Amazonie, que ce soit pour le pâturage ou la culture, ou pour la construction d’infrastructures telles que des routes, des logements, etc. La déforestation peut favoriser la présence et la prolifération de réservoirs et/ou de vecteurs d’agents pathogènes, ainsi que l’exposition des populations humaines à ceux-ci. Elle peut ainsi contribuer à augmenter le risque d’émergence ou de recrudescence de certaines maladies infectieuses (entre autres, le paludisme, la rage).
Dans les deux régions mentionnées précédemment, il existe des données et des connaissances dans de nombreux domaines (climat, utilisation des terres, faune sauvage, santé humaine et animale, etc.) et des cadres méthodologiques (One Health, Planetary Health, Sustainability Science) qui favorisent désormais des approches holistiques et des voies de changement (par exemple, la théorie du changement One Health). Cependant, il existe encore un manque d’observations liées à des contextes très spécifiques ; les connaissances des communautés locales ne sont pas nécessairement prises en compte ; la découverte, l’accès et la réutilisation des données d’un domaine à l’autre restent difficiles, nécessitant de multiples domaines d’expertise et l’accès à un grand nombre d’entrepôts de données différents et non interopérables ; et les approches holistiques ne sont pas suffisamment équipées pour mettre en œuvre réellement la transdisciplinarité.
Regardez notre vidéo sur la Santé Planétaire / Une seule santé
Présentation sur la Santé Planétaire/Une seule santé par Serge Morand lors de la réunion de lancement du projet MOSAIC (février 2024)